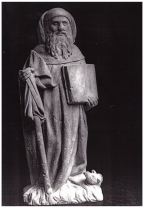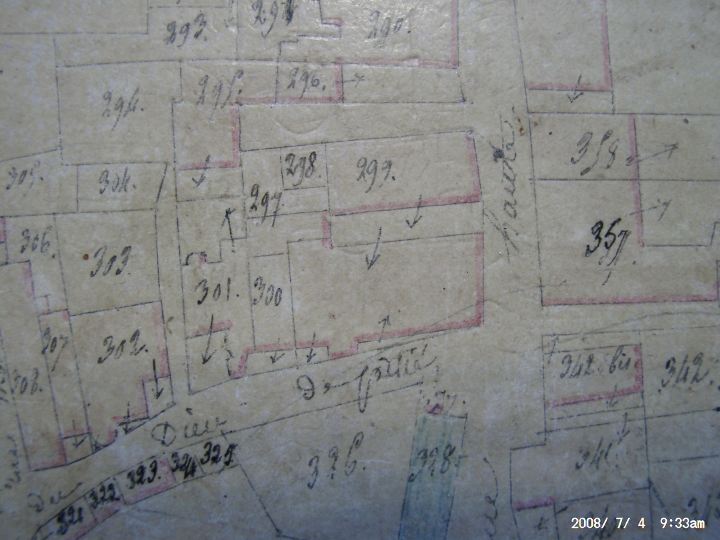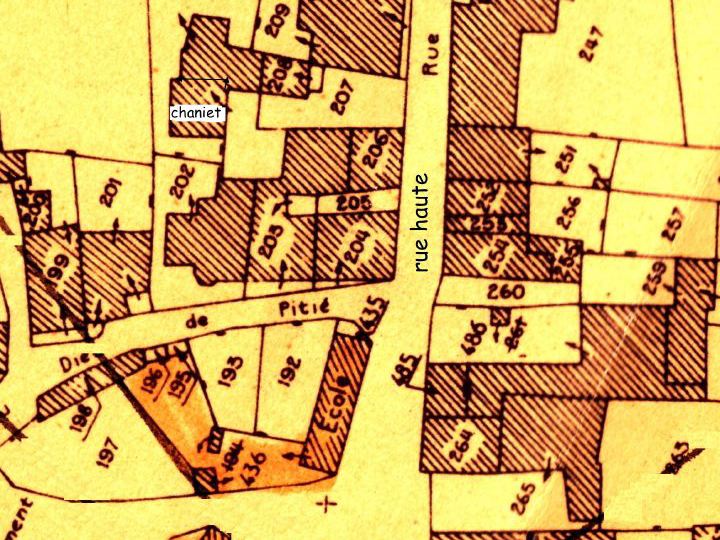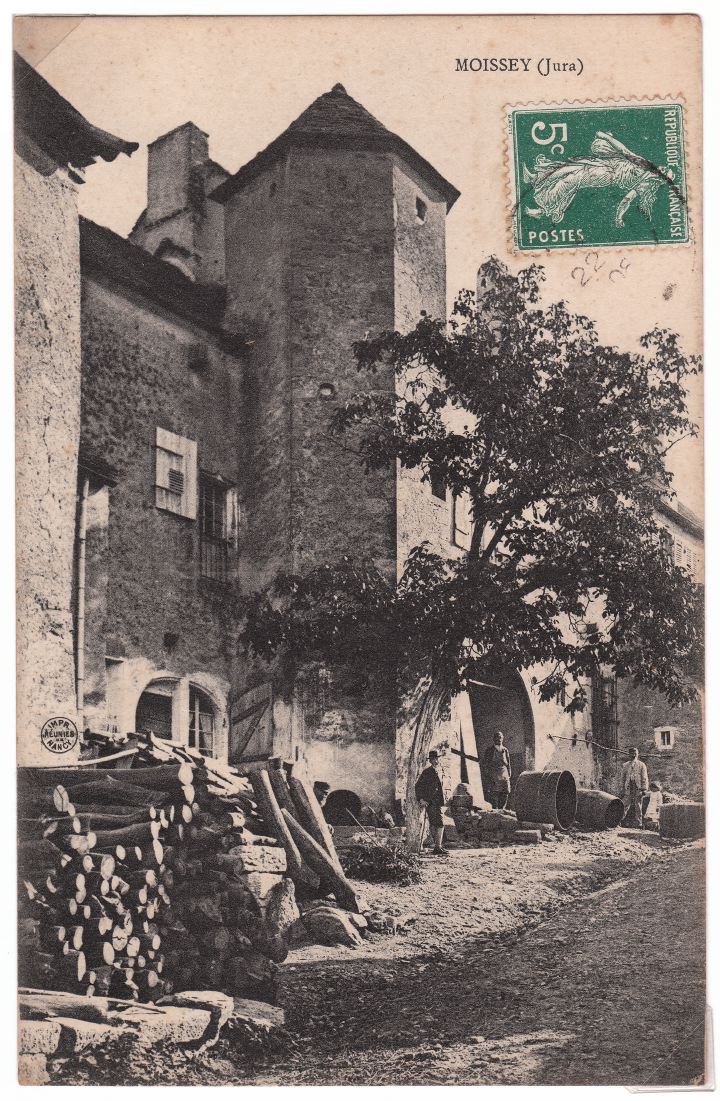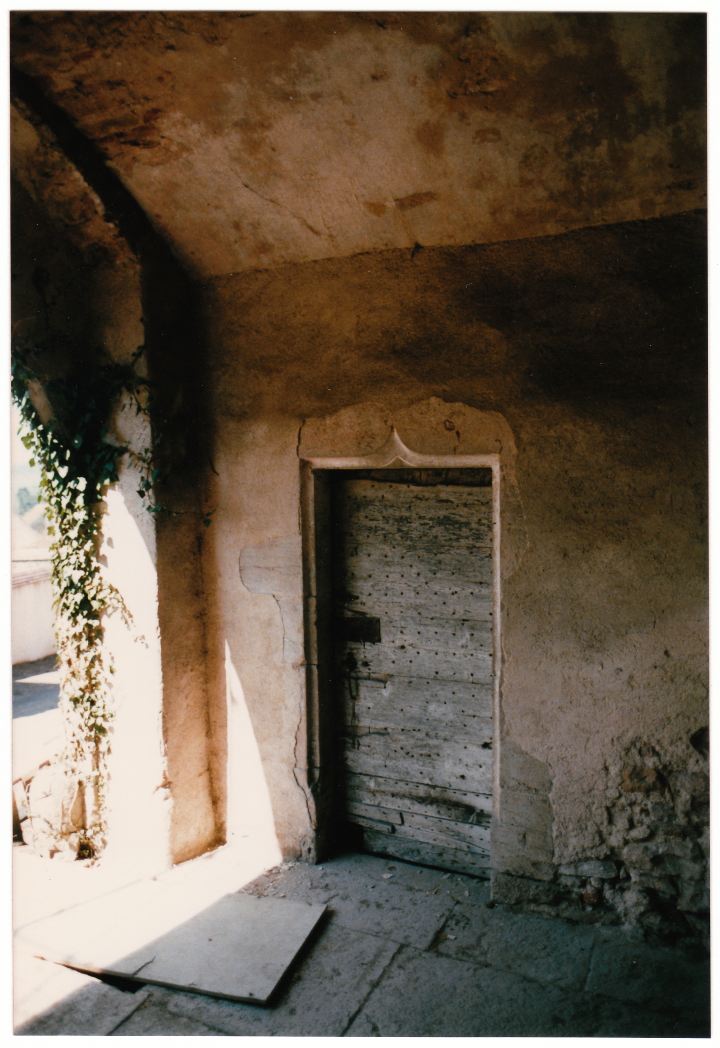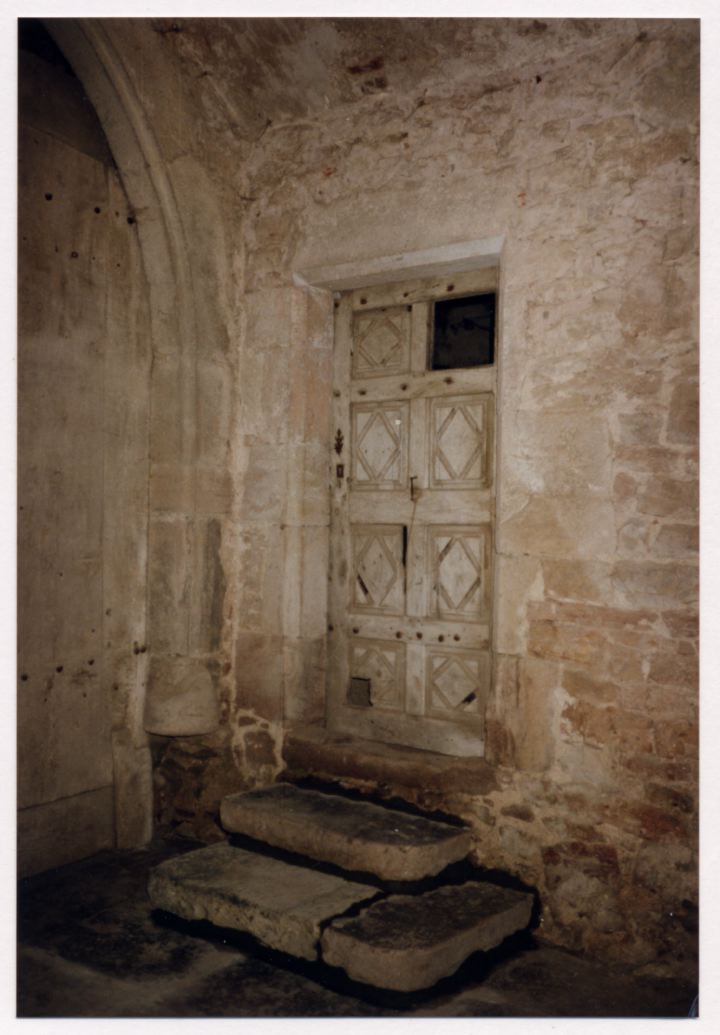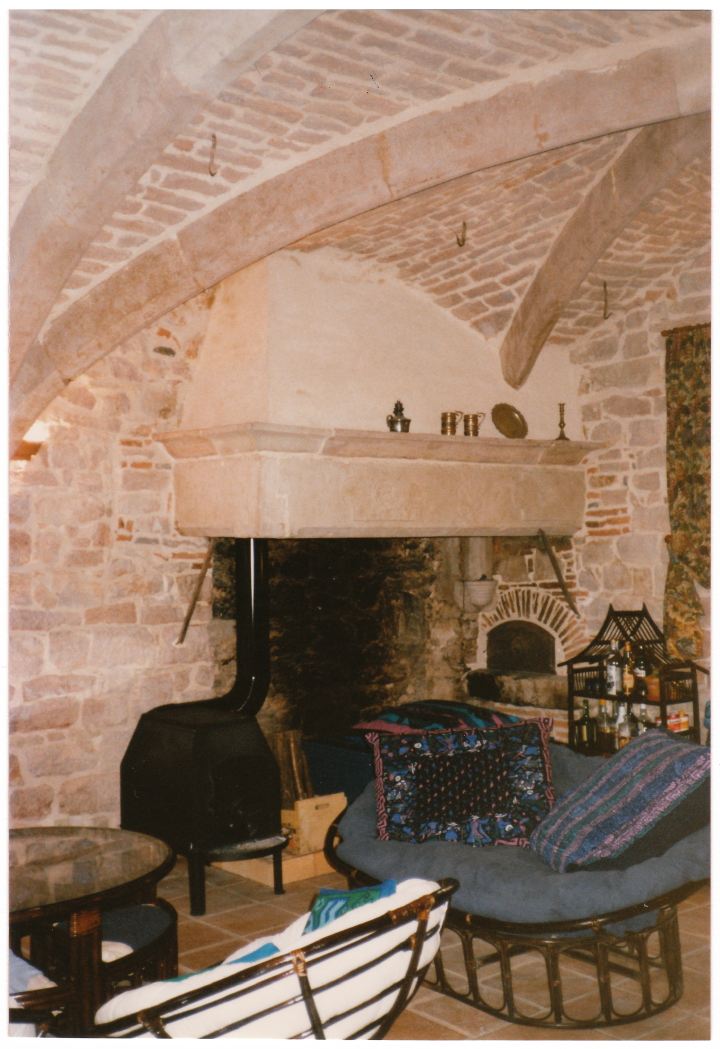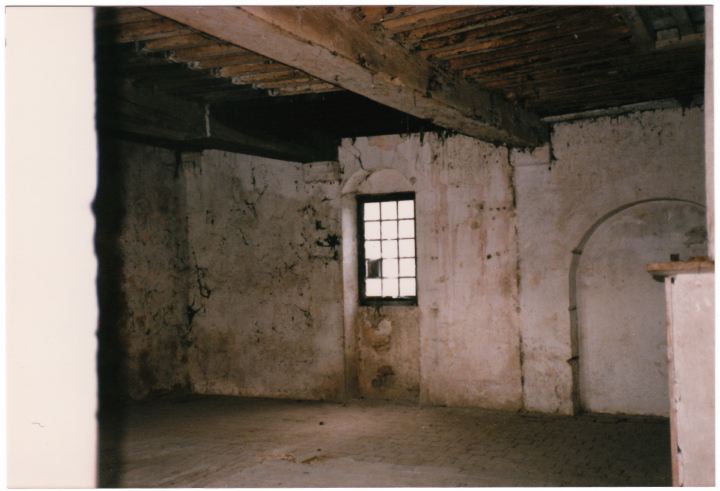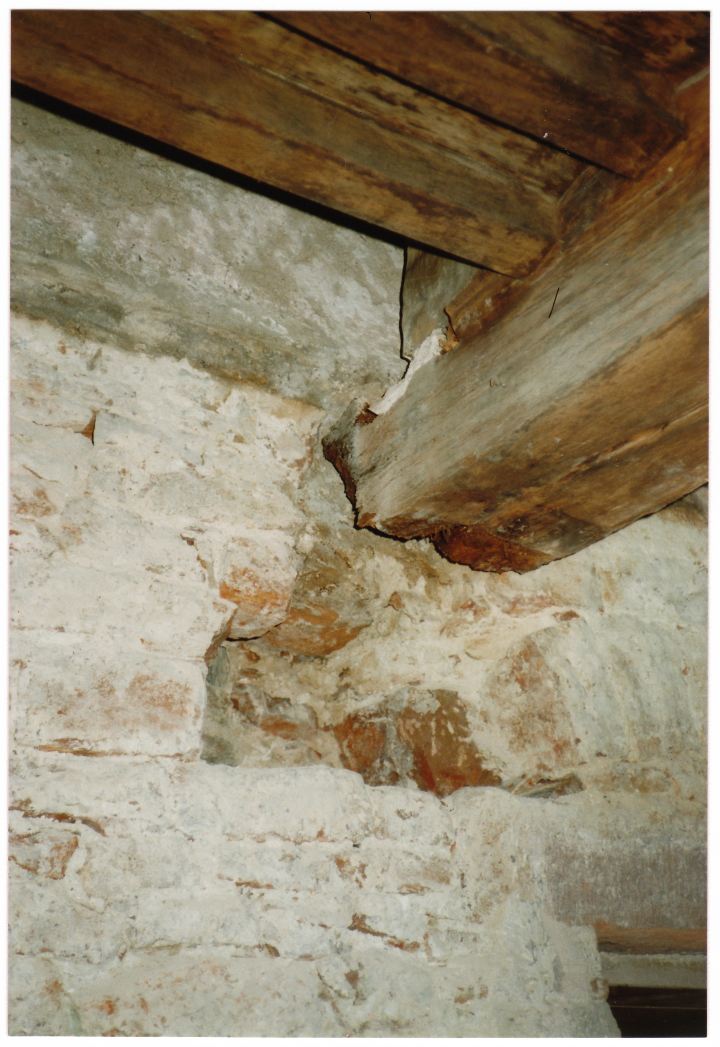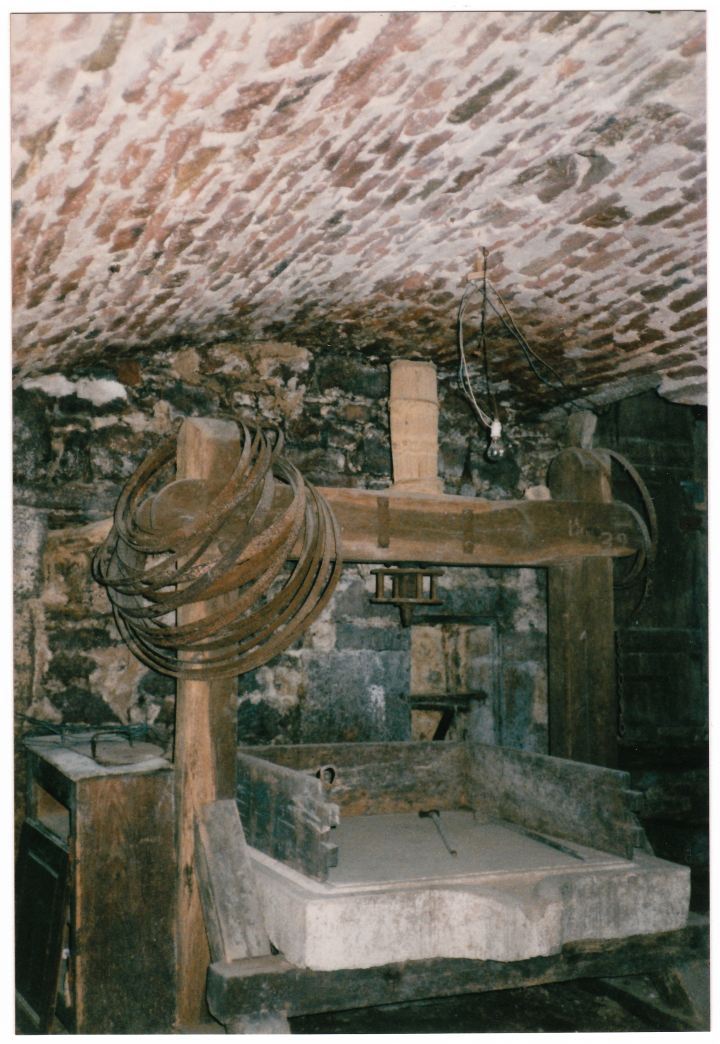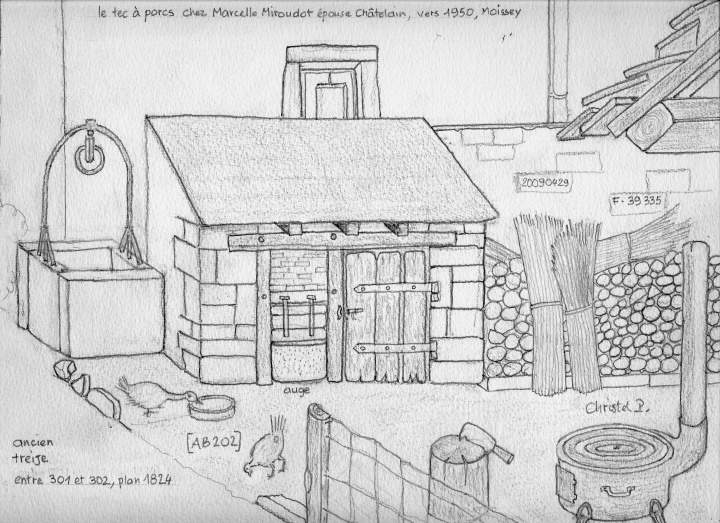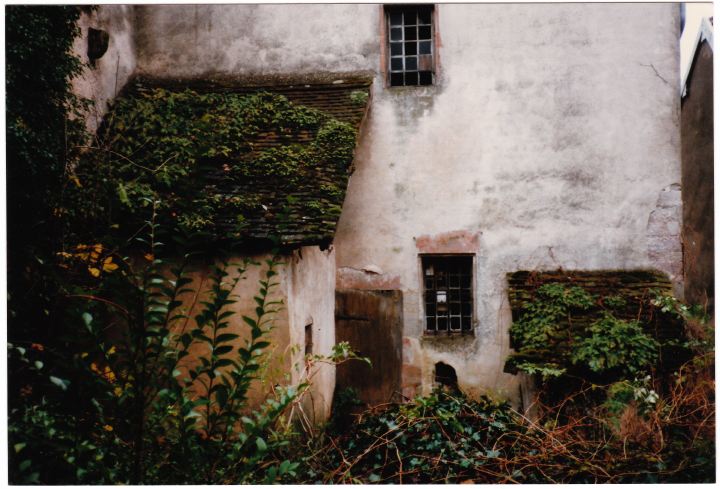la maison Miroudot
[AB 202]
La maison Miroudot est
certainement la plus étonnante et la plus belle
maison du village, toute de bois et de pierre, de facture
à peine spartiate... Retirée de la route de
quelques mètres, ses deux façades sont un
peu en retrait l'une de l'autre, la tour hexagonale
dissimule cette disparité, qui semble-t-il,
n'aurait qu'une fonction, c'est de desservir les deux
bâtiments en même temps. Ce petit angle droit
permet d'aménager les entrées,
elles-mêmes perpendiculaires entre
elles.
Après qu'on ait eu le
coup de foudre pour cette maison, il faut ensuite
intégrer, et cela aussi est bien insolite, qu'elle
a été habitée par une personne tout
ce qu'il y a de plus simple, allumant son feu tous les
matins et se servant de son réchaud à
alcool en cas de besoin, vivant d'une vache et de sa
vigne, se réfugiant à la cave pendant
l'orage. Un robinet [arrivé en 1963] sur
la pierre de l'évier, et voilà tout le
confort qu'a offert ce lieu jusqu'en 1988, date du
changement de propriétaire.
Après le
décès de la Marcelle, la demeure a
été acquise par un jeune couple, M. et Mme
Barlet, qui ont dépensé beaucoup
d'énergie à raviver toutes ces belles
choses: toitures, sablage des pierres de la grande salle
d'accueil, eau, électricité, chauffage,
double-vitrage, aménagement de l'étage,
salles de bains, c'est-à-dire le confort
d'aujourd'hui sans nuire au cachet d'antan.
En 1992, ce couple est reparti
sous d'autres cieux et la maison a été
reprise par la famille Perrin, qui heureusement
partageait les mêmes valeurs et même plus
puisqu'elle compte dans ses rangs des
médiévistes convaincus et
pratiquants.
C'est dire que pour l'heure les
destinées de ce couvent Saint-Antoine sont en de
bonnes mains, et c'est peut-être sa
rusticité qui l'a mis à l'abri des
bourgeois qui gravitaient pas mal entre Dole, Auxonne et
Pesmes, qui trouvaient l'endroit à leur
goût, mais trop petit, même pas la place pour
creuser une piscine... Grand bien lui en a pris à
cette maison, inextensible sur ses quatre points
cardinaux, courette devant, jardinet
derrière...
La
construction.
Elle commence par la cave,
accessible de la tour et de l'extérieur,
construite à partir de deux mâts de section
carrée (environ 12 cm), érigés
presqu'aux extrémités d'un futur
demi-cylindre -en berceau- et qui serviront de
repères précis pendant qu'on montera et
couvrira le coffrage (une voûte en planches) de
pierres sur chant selon l'explication d'Ivan
Perrin.
Le rez-de-chaussée est
une unique grande pièce, composée de deux
croisées d'ogives, séparées par un
arc en plein cintre. Les culots sont massifs et bien
finis, les nervures irréprochables. Une belle
cheminée d'angle, marquée de deux fleurs et
d'un rameau de 6 feuilles de chêne, accueille la
bouche d'un four piriforme (de plan en forme de poire)
qui est, lui, construit à l'extérieur, sous
un toitelet qui lui est propre.
Au-dessus, plafonds à la
française avec des poutres de section
carrée et des chevrons de chênes,
très serrés, presque un sur deux. Les
extrémités des poutres reçoivent les
fermes de la charpente, elles-mêmes
constituées par des bois de carène, tordus
dans un angle de 135 degrés, ou cintrés par
le marchand, ou élevés en forêt des
décennies à l'avance en privilégiant
(ou en contraignant) des fourches de gros arbres, on ne
sait pas.
L'ensemble a été
contruit strate par strate, ce qui imposait à
l'architecte de ne pas avoir les deux pieds dans le
même sabot, c'est-à-dire, ne pas oublier les
niches, les culots, les tablettes, les marches, les
linteaux, les ouvertures, enfin tout ce qui
apparaît comme parfaitement intégré
à la construction et qui est parfaitement visible
aujourd'hui.
Arrivés dans les
étages, les maçons n'évacuaient pas
les déblais de construction qui jonchaient
ça et là, et qui sont restés pour
servir d'assise aux futurs carrelages.
Le cas de la charpente est
très intéressant. Les bois de carène
étant cintrés pour faire un angle de 135
degrés, la pente de la toiture était donc
prédéfinie, c'est-à-dire 45
degrés avec la verticale, c'est-à-dire, une
pente absolue de 45 degrés. Quelle que fût
la distance entre les murs, la pente serait immuablement
de 45 degrés.
Dans les siècles
passés, on ne changeait pas sa toiture
périodiquement, et même on n'en changeait
jamais: elle était régulièrement
entretenue, on changeait les tuiles qu'il fallait, et
parfois les bois. Les chevrons, souvent en coeur de
chêne, ou en demi-coeur (de petit chêne),
pouvaient durer des décennies. Quant aux gros
bois, ils ont trois siècles d'âge et s'en
portent fort bien. Le tout est de faire la chasse
à l'eau.
L'ensemble de la charpente, qui
nous semble surdimensionnée aujourd'hui, avait
cette force qui permettait de soutenir une couverture en
petites tuiles, bien plus lourdes au
mètre-carré que les grandes tuiles
mécaniques utilisées au XXe siècle.
On peut imaginer qu'au moment de la construction, la
couverture était en pierre(s). Laves ou
loses.
Il faut souligner enfin la
présence d'une porte d'entrée imposante,
genre petite porte charretière, qui,
charretière, ne l'est pas. Cette porte
était donc destinée à recevoir du
monde. On doit pouvoir dire qu'elle est l'entrée
principale.
Ces voûtes en bas, ces
plafonds en haut, sa haute tour qui va de la cave aux
combles font de cette construction un modèle de
l'architecture [rurale ou non] du XVIIe
siècle.
les hypothèses
de construction
A l'évidence, la haute
tour dessert un module d'habitation, à gauche en
regardant, et à droite, un module de service
(remise à charrettes en bas, grange à foin
au dessus), incluant un porche au rez-de-chaussée
qui lui même ouvre sur une autre construction tout
aussi remarquable, à 5 croisées d'ogives (3
dans une pièce, 2 dans l'autre) et
vraisemblablement pas d'étage. Ce module de droite
[aujourd'hui AB 203], qui a appartenu au
père des soeurs Durot, riche de
présomptions, fait l'objet d'un
autre article. Ce module
contient les sceaux christique et marial, la croix du
Temple et les dates, 1615 pour la pièce à 3
croisées d'ogives, 1617 pour celle qui en a deux.
Tout cela nous en dit assez long pour que nous pensions
que la demeure dont nous parlons a pu être mise en
chantier autour de 1612.
Pour ce qui est du reste de
l'immeuble, l'étage manquant de AB 203 et la
maison AB 204, ces deux éléments sans
croisées d'ogives, sans plafond à la
française, sans charpente "marine", Ivan Perrin
(voir les
premiers dessins de son
hypothèse) propose que
ces ajouts sont postérieurs et commandés
par un certain
Claude
Sireguy,
qui signe sa construction sur un linteau de
l'entrée Est [+ 16
C
T
S
92 +] d'une part et sur une belle plaque de
cheminée
[Claude
Siregui
1688] d'autre part.
Sur le plan cadastral ancien
[1824], les parcelles AB 203 et AB 204 sont les
deux sous le même numéro (299).
les hypothèses
de destination
Ces hypothèses ne sont
pas nombreuses. Tous les éléments
constitutifs de la bâtisse rappellent
immanquablement le mode de construction des
églises. On pense d'emblée à
l'installation d'une congrégation. La croix
templière de la clef de voûte nous indique,
ou bien qu'elle a été mise ici pour faire
joli, ou bien qu'on héritait de la tradition de
l'Ordre Hospitalier des Chevaliers de Malte. Cette croix
templière pourrait aussi expliquer à elle
seule la structure de toutes les croix pattées du
secteur.
Edmond Guinchard, le monographe
de Moissey [1913], et Marcelle Châtelain,
évoquent la présence, en façade,
d'une niche qui aurait abrité un Saint-Antoine et
son cochon. On serait dans ce cas chez l'Ordre de
Saint-Antoine, congrégation masculine servant au
cours des âges de Secours Catholique Local, mais
ayant en tout cas servi -à une période-
à soigner le
mal des ardents, (ou Feu de
Saint Antoine par similitude avec les tentatives du
démon pour entraîner le saint en enfer) la
grande pièce du rez-de-chaussée servant de
pièce commune et l'étage servant de
dortoir, non pas aux malades, mais au personnel
hospitalier.
Ajoutons à cela que le
linteau Est de AB 204, au chiffre de Claude Sireguy,
contient un
Tau
de toute beauté, qui est la marque de l'Ordre
Hospitalier de Saint-Antoine...
"Pour
guérir de cette maladie
[
l'ergotisme, qui a fait des centaines de
milliers de morts à partir du
Moyen-âge et jusqu'au début du
XXème siècle; on l'appelait alors
"Mal des Ardents" ou "Feu de Saint Antoine",
à cause de brûlures ressenties dans
les membres des malades, et en
référence aux tentatives du
démon d'entraîner le Saint en
enfer.],
on invoque Saint Antoine
car un gentilhomme dauphinois aurait obtenu la
guérison de son fils lors d'un
pélerinage auprès de ses reliques;
celui-ci crée une communauté à la
fin du XIème siècle, qui évolue
vers un ordre religieux: les Antonins (à
Saint-Antoine-en-Viennois); au XVème
siècle, ils sont près de 10 000 moines
et ont fondé plus de 300 abbayes ou
commanderies.
On pense qu'à
Moissey, rue du Dieu de Pitié, se trouvait un
Couvent des Antonins; une statue de Saint Antoine
(avec son cochon) se serait trouvée dans la
niche de sa façade, selon les
témoignages des anciens.
On sait peu de choses sur
les soins prodigués aux malades (les
démembrés) qu'ils soignaient de
façon empirique: ils leur concoctaient un
médicament à base de vin mis en contact
avec les reliques de Saint Antoine et priaient pour
eux .
Les Antonins demandaient
l'aumône et avaient le droit de faire divaguer
leurs cochons dans les rues, ce qui soulevait beaucoup
de protestations.
Sur leur manteau à
capuchon était cousu le "Tau", (le signe de
l'ordre en forme de T, désignant une
béquille?), en tissu bleu, sur
l'épaule.
Cet ordre est
méconnu car ses archives furent
détruites en 1422 par un incendie, puis en 1567
par les Huguenots."
L'ordre décline
à partir du XVIIIe siècle car les
épidémies du mal des ardents
régressent. Il est alors réuni à
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (plus connu
sous le nom d' Ordre de Malte) le 25 juillet
1777.
La question qui demeure est la
suivante: dans notre affaire, la Croix des Templiers
apparaît en 1612 et le Tau des Antonins
apparaît en 1692. Donc les Antonins deviennent
membres de l'Ordre de Malte alors que ces dates nous font
penser à une chronologie inverse. Depuis les 1777,
l'Ordre de Saint-Antoine a rejoint celui de Malte, qui
existe toujours, et auquel chacun pouvez adhérer
si le coeur lui en dit.
L'explication qui subsiste
serait que la réunion des deux Ordres aurait pu
avoir lieu, localement, bien avant 1777,
c'est-à-dire entre 1612 et 1692...
|