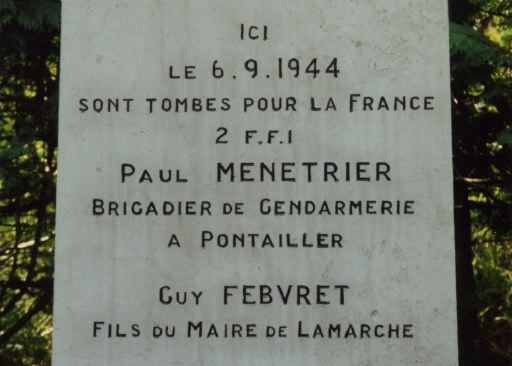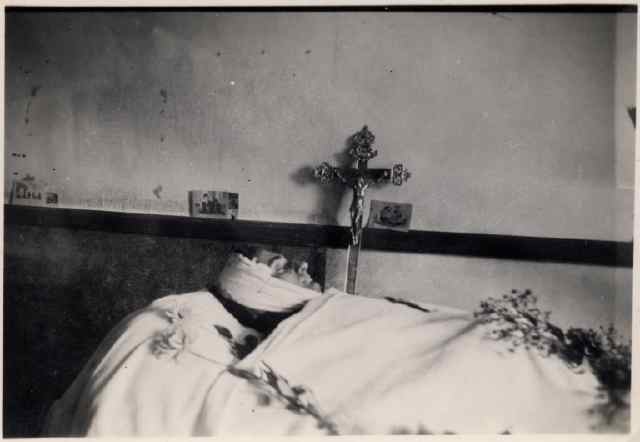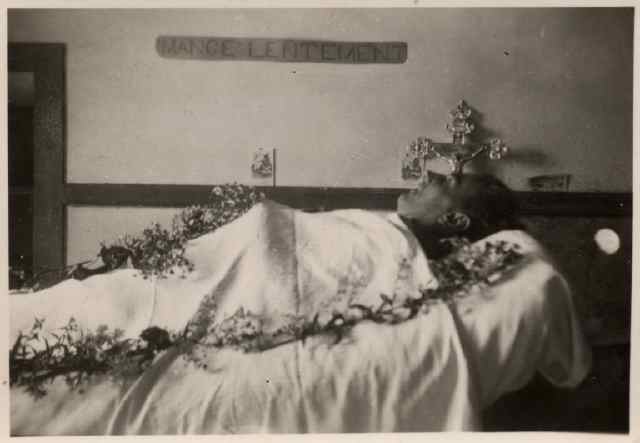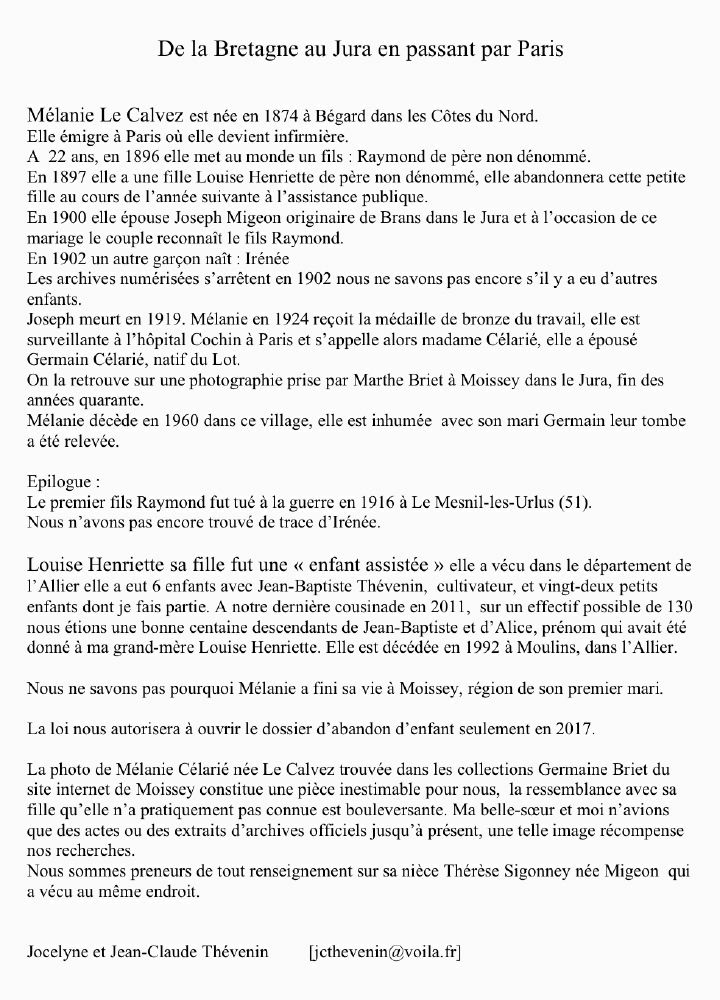|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thérèse Sigonney, avant d'habiter
à Moissey et de s'appeler Madame Noël, est
née à Montmirey-la-Ville, le 14 novembre
1915.
C'est en février 1922 qu'elle s'installe avec
sa nombreuse famille (8 enfants, puis 7), à la
tuilerie dite la Tuilerie Bouveret. Il s'agit de la
tuilerie de ChâteauNeuf qui jouxte au nord le
domaine de Mademoiselle Exupère Moréal,
célèbre cavalière et
célibataire du temps passé (XVIIIe
siècle). De cette tuilerie (ZD 104), il restait au
moment où elle est arrivée là, en
1922 et il reste encore en 1996, alors que
Thérèse va sur ses 81 printemps, des
vestiges certains de la réalité
d'autrefois, en particulier un hangar de séchage,
très caractéristique par son faîtage
rehaussé, et des trous dans la pâture, ceux
d'où on extrayait la glaise.
Elle a fait ses classes auprès de Mlle
Marie-Justine Digrado, dans la classe enfantine du
rez-de-chaussée de la petite école (AB
436), puis elle a suivi dans la grande classe
auprès de Edmond Guinchard, peu de temps, puis de
M. Poussot jusqu'au certificat, à 12 ans, dans la
classe de l'immeuble de la Mairie, (AB 191).
Bien plus tard, elle a connu M. Georges Lesnes et M.
Henri Lépeule, instituteurs au long cours, puisque
ses 4 enfants, un garçon, trois filles, ont
fréquenté l'école primaire de
Moissey:
Monique née en
1935,
Daniel en 36,
Jacqueline en 40 et
Marie-Claude en mars 42.
|
Le Tacot.
Adolescente, Thérèse Sigonney a pris
maintes fois le Tacot pour aller faire des emplettes
à Dole, pas aussi souvent qu'aujourd'hui
déclare-t-elle. Ses souvenirs sont
précis :
"Quand on entendait la machine siffler à
Menotey, on avait juste le temps de descendre de la
Tuilerie jusqu'à la gare, juste pour accueillir
les voyageurs qui descendaient à Moissey.
Le Tacot, c'était une véritable
attraction, certainement il était utile aux
professionnels, mais nous, nous le prenions pour aller
à la ville. Il était rustique et pas
rapide, mais nous étions ravies de le
prendre.
Nous n'allions pas tous et pas toujours à
la ville; de nombreuses personnes confiaient leurs
"courses" à la Cossotte, une femme qui s'y rendait
régulièrement avec sa charrette en osier.
Elle faisait les commissions pour tout le monde.
Et puis, la gare (emplacement AB 46) était
le pôle d'attraction du dimanche, c'était un
but de promenade et de stationnement, on allait voir qui
montait, qui descendait du train; filles et
garçons, tous s'y rendaient, c'était en
quelque sorte un lieu de rencontres..."
Comme sa famille était paysanne, il lui
arrivait souvent d'aller garder les vaches -après
le certificat d'études- dans le bois, dans les
Carrières Meulières, c'est-à-dire
à la limite sud de Moissey et de la Commune de
Frasne :
|
La Crasse.
"J'ai bien connu les Carrières de Crasse,
avec ses creux et ses bosses, mais elles n'étaient
plus en service, mis à part un grand de Frasne, un
certain Jules Larivière, qui venait y travailler
à pied, autour des années 1927 ou
28".
Puis à 19 ans, c'est l'heure où les
grands destins se nouent, elle passe devant le Maire
Ernest Odille et l'Abbé Léonide Richard,
avec Monsieur Victor Noël, le 29 septembre
1934.
C'est son frère Paul qui la conduit aux autels
puisque son père est décédé
lorsqu'elle avait 6 ans. Paul, Joseph et Ferréol,
sont les trois hommes, ses frères, qui ont fait
tourner la boutique agricole.
Dans la maison (ZA 52) qu'elle occupera avec son mari
et sa tante, la maison témoin du drame de 1944, il
y avait un puits, mais bientôt, Victor installa un
groupe pour faire monter l'eau sur l'évier.
|
La sablière (AC 45) de M. Marcel
Dubuc,
propriétaire aisé de quelques bois de
Moissey, elle s'en souvient bien aussi, Son frère
Paul y débardait du bois à mulets ou
à chevaux, puis, bien plus tard, les Routiers de
la section de Moissey de leur syndicat (fondé par
Victor, son époux au moment du Front Populaire), y
faisaient le méchoui "syndical" à
l'occasion du Ier mai.
D'après Thérèse, ce sont ces
mêmes routiers qui sont à l'origine de la
transformation de la cave de la nouvelle école (AB
266) en caveau municipal, puisqu'à cette
époque, autour de 1970, ils y organisaient parfois
le bal annuel des routiers.
Ce dossier avait été monté par
Léon Désandes, maire depuis 1965,
déjà assisté d' un jeune technicien
de la DDE, le futur brillant maire et plus tard
Conseiller Général, Bernard Chauvin.
Ensuite des liens s'étaient tissés
entre Monsieur Dubuc et la famille Noël. Puis
à la mort de Marcel Dubuc, les héritiers se
défirent de cette parcelle qui tomba dans la
propriété de gens du Haut-Doubs qui la
clôturèrent pour raisons
cynégétiques.
Le kilomètre-carré ainsi soustrait aux
promeneurs du dimanche provoqua un peu d'émotion
chez les randonneurs du fait que dans les usages de la
Serre, on pouvait être propriétaire de bois,
sans jamais grillager son bien.
|
Les Gorges, le lavoir.
Les Carrières militaires des Gorges, qui ont
été ouvertes au milieu de la grande guerre,
ont dû décamper rapidement, car si en 1925,
on voit encore des tas de gravats, en 1935, les dames qui
y vont à la lessive ne savent pas toutes qu'elles
pataugent à proximité d'une ancienne
carrière militaire. Bien que plus
éloigné que la Grande Fontaine centrale du
village, le lavoir des Gorges attire toutes les
lavandières de la rue de Dole, certainement pour
des raisons d'habitudes, mais aussi beaucoup parce l'eau
de la future Brizotte y est considérablement moins
calcaire, ce qui fait bien l'affaire des femmes qui
lavent. Le lavoir est couvert, certes, mais il faut s'y
rendre avec la brouette chargée de linge et
ça, c'est pénible.
Madame Noël ajoute à son propos, et
presque malicieusement, que le lavoir des Gorges
était un haut lieu d'échanges,
d'échanges d'informations et sûrement de
commentaires...
|
Les Gorges, la
carrière.
C'est cette carrière militaire-là,
donneuse de mauvais matériau d'empierrement qui
est sur le même filon que le gisement d'Eurite,
connu très loin d'ici par les constructeurs de
routes, pour la solidité de ses graviers.
|
La carrière d'Eurite, sur le CD
37,
Elle est née vers 1925 et tourne encore
à la fin du siècle, en extrayant un
porphyre "bleu" de toute bonté mais aussi de toute
beauté.
Madame Noël la connaît bien, non seulement
parce qu'elle a été ouverte au moment
où elle était gamine, mais surtout parce
que son mari y avait travaillé au temps de la
gérance de Marcel Téliet. Victor Noël,
lorrain d'origine, travaillait sur des chantiers de M.
Téliet à Valdahon et à
Besançon. Il était carrier et il y
travaillait à l'entretien. A cette époque,
M. Téliet employait pas moins d'une centaine
d'ouvriers. Cette carrière qui existe toujours, a
été conduite par la famille Pernot de 1960
à 1997.
Victor logeait à la pension Arsène
Ardin (AB 71), juste en face de la Grande Fontaine et
c'est au cours des déplacements ordinaires dans le
village que Victor et Thérèse se sont
rencontrés.
Puis, parmi les grands événements qu'a
vécus Thérèse Sigonney, il y a la
guerre de 40.
|
|
|
les
événements de château neuf
1. Le "feu"
à la tuilerie (lundi 4 septembre
1944).
"On n'a jamais caché
de résistants à la Tuilerie (ZD 104),
c'était beaucoup trop dangereux. Naturellement,
quand des égarés recherchaient à
rejoindre la ligne de démarcation, la Loue, on les
renseignait du mieux qu'on pouvait.
A mon avis, on a dû
être dénoncés, vous savez comme c'est
dans les petits villages.
Un soir, en pleine nuit
même, sont arrivés. à la Tuilerie un
groupe d'Allemands, avec le Maire, Ernest Odile, je ne
sais pas combien ils étaient. Ils étaient
venus pour chercher des résistants qui,
croyaient-ils, étaient cachés chez nous.
(Enfin, chez ma mère!). Ils ont tout
retourné partout mais ils n'ont rien
trouvé. Complètement dépités,
ils voulaient mettre le feu à la ferme. Ils ont
mis en joue mon frère Ferréol, ma
mère a pleuré,
pleuré.
Pour finir, ma mère
leur a montré une lettre de Joseph qui
était prisonnier, dans laquelle il mettait qu'il
était bien traité. C'est sûrement
cette lettre qui les a attendris et ils ont tous
disparu."
2. Les 2 FFI du
monument, (mercredi 6 septembre
1944).
"J'étais aux
premières loges, raconte-t-elle.
Le 6 septembre 1944, en
début d'après-midi, arrivent de
derrière chez nous, comme en provenance de la
Roche Tillot, une bande de résistants qui
voulaient rejoindre la maison de Marcel Thomas (ZD 138),
à Château Neuf, pour y faire cuire une
poule. Je leur ai dit de se sauver, que c'était
dangereux.
J'étais toute seule,
mon frère Ferréol était parti aux
champignons, Paul était prisonnier, Joseph aussi
et Victor était descendu au village en
vélo. J'étais seule avec ma petite
Marie-Claude et ma tante. Mes trois autres enfants,
Monique, Daniel et Jacqueline étaient à la
Tuilerie chez ma mère, cachés au moment de
l'escarmouche dans le poulailler ou l'écurie, je
ne sais plus.
Au même moment,
arrivent du haut des platanes des Allemands qui
descendaient le faubourg. Depuis là où ils
étaient, ils avaient dû voir quelque chose,
aussi, j'ai redit aux résistants qu'on allait tous
se faire tuer. Rapidement, les uns se sont couchés
dans le fossé, des autres sont allés
derrière le tas de bois.
Les Allemands ont
brûlé le hangar en face de chez
Gilles.
|
|
|
Les Allemands
ont brûlé le hangar en face de chez
Gilles. On voit la maison de
Thérèse, à gauche sue cette
image.
|
|
|
Moi, avec ma petite de deux
ans et demi et ma tante, je me suis
réfugiée à la cave. Pourtant, je
m'étais toujours juré qu'en mauvais cas, je
n'irais jamais à la cave. Un résistant
qu'on appelait Tarzan, m'accompagnait, il s'est
caché dans un saloir, on voyait ses jambes qui
dépassaient et son fusil était posé
à côté. Il y a eu de la
pétarade, des grenades ont explosé.
Ça a duré une heure et demie, puis plus
rien. Le calme avait dû revenir. L'homme qui
était caché à la cave m'a
dit:
«passez devant,
vous êtes une femme, vous ne risquez
rien».
Courageux comme il
était, je suis donc remontée. Il n'y avait
plus personne, un mort
[Guy Febvret,
né en 1922, de
Lamarche-sur-Saône]
devant la maison, là où il y avait un gros
platane, en face de chez nous, il avait la corpulence de
Joseph, et un autre
[Paul
Ménétrier, brigadier de gendarmerie
à
Pontailler], qui
avait un éclat dans le bras, avait couru en
direction des Gorges, mais il se saignait et il est mort
peu après.
Puis, un camion qui
remontait, un camion allemand, a tout embarqué, il
ne restait que du sang.
Ce sont ces deux hommes qui
ont leur nom sur le Monument (ZD 139) qui est juste en
face de ma maison. [Paul Ménétrier,
brigadier de gendarmerie à Pontailler et Guy
Febvret, fils du maire de Lamarche] Ma fille,
Marie-Claude, qui avait deux ans et demi, dit qu'elle se
rappelle encore comme ça avait fait
"boum".
J'avais eu un moment
l'idée d'observer les événements
depuis ma lucarne d'évier, mais je ne l'ai pas
fait, allez savoir pourquoi. Et j'ai bien fait, car,
quand je suis revenue dans ma cuisine le carreau avait
sauté et plus tard, en prenant du linge dans
l'armoire de ma chambre, j'ai trouvé une balle,
puis le trou de la balle dans la corniche de l'armoire.
Si je m'étais mise au carreau, cette balle
était pour moi. D'ailleurs, je l'ai encore. Je
l'ai gardée!
Pendant cette guerre, nous
n'avons jamais manqué, à la campagne, on
avait quand même de quoi...
|
lire de René Delmas, historien du
village, le Combat de
Moissey
|
enfin
Lorsqu'on demande à
Madame Noël ce qui l'a le plus frappée tout
au long du XXe siècle, elle déclare que
c'est le progrès, tout le progrès, l'eau,
le lave-linge, le frigo, la télé, la
voiture et sûrement l'avion, puisque rien que cette
année (en 1996), elle est allée trois
semaines en Australie pour le mariage de son
petit-fils.
Mais elle connaissait
déjà l'Indonésie, la Californie, et
la Yougoslavie avant les
événements...
Je n'ai pas peur de prendre
l'avion, dit-elle en souriant.
|
propos recueillis par Christel Poirrier, le
lundi 1er juillet 1996.
|
|
|